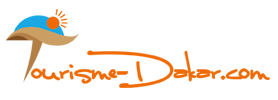- Le football
 Le football est un sport très apprécié des Sénégalais. L'équipe du Sénégal de football, dont les joueurs sont surnommés les Lions de la Téranga, est affiliée à la Fédération sénégalaise de football et à la FIFA depuis 1962. En 2002, au Mali, elle a manqué de peu la coupe d'Afrique face au Cameroun en finale et demi-finaliste de l'édition 2006. Elle se qualifie à la même année (2002) pour la phase finale de la coupe du monde de la FIFA, organisée en Corée et au Japon. L'équipe du Sénégal bat la France (championne du Monde et d'Europe en titre) en match d'ouverture de la coupe du monde. Parmi les grands footballeurs sénégalais, on peut citer El-Hadji Diouf, Henri Camara, Khalilou Fadiga, Habib Beye, Tony Sylva, Mamadou Niang, Omar Daf, ou, dans le passé, Jules François Bocandé, mais aussi le manager Pape Diouf, ex-président de l'OM.
Le football est un sport très apprécié des Sénégalais. L'équipe du Sénégal de football, dont les joueurs sont surnommés les Lions de la Téranga, est affiliée à la Fédération sénégalaise de football et à la FIFA depuis 1962. En 2002, au Mali, elle a manqué de peu la coupe d'Afrique face au Cameroun en finale et demi-finaliste de l'édition 2006. Elle se qualifie à la même année (2002) pour la phase finale de la coupe du monde de la FIFA, organisée en Corée et au Japon. L'équipe du Sénégal bat la France (championne du Monde et d'Europe en titre) en match d'ouverture de la coupe du monde. Parmi les grands footballeurs sénégalais, on peut citer El-Hadji Diouf, Henri Camara, Khalilou Fadiga, Habib Beye, Tony Sylva, Mamadou Niang, Omar Daf, ou, dans le passé, Jules François Bocandé, mais aussi le manager Pape Diouf, ex-président de l'OM.
- La lutte
 La lutte sénégalaise est une pratique ancrée dans la tradition. La lutte sénégalaise n'a rien perdu de sa popularité, à travers des combats aussi brefs que spectaculaires. Ce sport est incarné par d'impressionnants champions tels que Yékini. Tradition destinée à célébrer la fin des récoltes, la lutte est devenue le sport national, détrônant même le football. Il se pratique partout : clandestinement, sur les terrains vagues, dans des tournois amateurs et dans des championnats professionnels médiatisés. La version sénégalaise, « avec frappe », autorise les coups de poing pour surprendre l'adversaire. Les combattants sont les héritiers d'une culture : ils se préparent en s'aspergeant de potions concoctées selon les recommandations des marabouts. Les cachets mis en jeu peuvent atteindre de nos jours près de 350 000 000 FCFA, soit 750 000 dollars.
La lutte sénégalaise est une pratique ancrée dans la tradition. La lutte sénégalaise n'a rien perdu de sa popularité, à travers des combats aussi brefs que spectaculaires. Ce sport est incarné par d'impressionnants champions tels que Yékini. Tradition destinée à célébrer la fin des récoltes, la lutte est devenue le sport national, détrônant même le football. Il se pratique partout : clandestinement, sur les terrains vagues, dans des tournois amateurs et dans des championnats professionnels médiatisés. La version sénégalaise, « avec frappe », autorise les coups de poing pour surprendre l'adversaire. Les combattants sont les héritiers d'une culture : ils se préparent en s'aspergeant de potions concoctées selon les recommandations des marabouts. Les cachets mis en jeu peuvent atteindre de nos jours près de 350 000 000 FCFA, soit 750 000 dollars.Traditionnellement, les premiers combats de lutte se déroulaient après la saison des pluies et opposaient les lutteurs de villages environnant dans des championnats appelés mbaapat. C’est le cas notamment dans les régions du nord, du Sine-Saloum et de la Casamance. Le vainqueur du tournoi pouvait remporter avec lui du bétail, des céréales et autres biens en jeu. Au fil du temps et du succès, les combats deviennent de plus en plus importants, les cachets des lutteurs aussi. De grands noms marquent l’histoire de la lutte sénégalaise : Falaye Baldé, Double Less, Mbaye Gueye (Tigre de Fass), Manga 2 (ancien roi des arènes) entre autres. Mais c’est avec l’avènement de Mouhamed Ndao (Tyson) que la lutte a pris son envol pour devenir un sport professionnel avec des cachets de millions de francs et un grand nombre de spectateurs. Aujourd’hui les combats sont de grands événements sportifs mobilisant les médias et l’attention des résidents et de la diaspora. Depuis mai 2010, Fabrice Allouche (ex-champion du monde de kickboxing) est le premier blanc à intégrer une école de lutte sénégalaise comme coach de boxe, préparateur physique et mental auprès de l'école Ndakaru.
Le règlement est très rigoureux et complexe. Il est appliqué par trois juges arbitres. Un combat dure quarante-cinq minutes en trois tiers temps avec des pauses de cinq minutes. Les lutteurs combattent à mains nues et sans aucune protection. Le combat se termine dès qu'il y a une chute d'un des lutteurs. On considère qu'il y a chute lorsque la tête, les fesses ou le dos du lutteur touchent le sol ou qu'il y a quatre appuis (deux mains et deux genoux) sur le sol. La victoire peut aussi être attribuée à un lutteur lorsque son adversaire ne présente plus les conditions physiques ou médicales aptes à la lutte.
- La boxe
- Le basket-ball
- Les faux lions
Le « Djaat » consiste à chanter les louanges du faux lion en question. Dans un discours épique, il faut rappeler ses actes héroïques, son courage ainsi que faire les éloges de sa famille et de ses ancêtres pour bénéficier de son calme et de sa clémence.
 Dans la tradition sénégalaise, le lion est le totem des « ndiayéennes » (ceux qui ont N’diaye comme nom de famille), donc ce sont eux qui ont le don de faire le « Djaat » à un vrai lion. Mais s’il s’agit d’un faux lion, ça reste l’apanage des « Guéweuls » (Griots) et « Niénio » comme le faisait respectivement Yves Niang et feu Ndongo Lô lors des « Simbs ».
Dans la tradition sénégalaise, le lion est le totem des « ndiayéennes » (ceux qui ont N’diaye comme nom de famille), donc ce sont eux qui ont le don de faire le « Djaat » à un vrai lion. Mais s’il s’agit d’un faux lion, ça reste l’apanage des « Guéweuls » (Griots) et « Niénio » comme le faisait respectivement Yves Niang et feu Ndongo Lô lors des « Simbs ». De Père Ngom à Papa Ngom en passant par Sadio Ndiaye ; sans oublier Aya Kane et Ibou Diagne, cette cérémonie culturelle « héroïque » s’organise autour des villages, des quartiers populaires, etc. Elle est riche en culture dans la mesure où elle combine la danse, le "sabar", mais aussi des pratiques plus ou moins mystiques.
Dès que les "sabars" résonnent, les enfants commencent à s’agiter, et les téléspectateurs viennent de partout. Petit à petit, une foule s’installe. Traditionnellement, les « faux lions » sont au nombre de quatre et arrivent un à un de façon hiérarchique ; après l’installation des entrées et des tambours-majors. Il ne faut pas oublier le « Goor-Jigeen » qui est un homme qui s’habille en femme pour susciter le rire et l’attention des téléspectateurs. Après les arrivées, les « faux lions », plus connus sous le nom de" Gaîndés", vont toujours à la quête des gens qui n’ont pas acheté de ticket et qui veulent assister clandestinement à la cérémonie. Et généralement, quand ils réussissent à attraper une personne, ils essayent de la faire danser sous peine de sanction publique (frapper, « griffer », etc.)
Hormis ces évènements particuliers, nous pouvons voir aussi de faux lions lors des combats de lutte ou d’autres évènements purement culturels. Pourtant, étant une chose purement culturelle occupant une place importante dans la tradition sénégalaise, le SIMB a aujourd’hui tendance à disparaître. La critique d’une éventuelle violence qu’il peut engendrer dans les quartiers est souvent avancée. Voilà pourquoi, il devient illégitime et est strictement interdit. Alors que cette thèse de la violence ne semble pas fondée, car nous savons pertinemment qu’il n’a jamais posé un problème grave dans la société. C’est une cérémonie culturelle bien aimée par les touts petits. Par conséquent, certains continuent à la pratiquer dans certains quartiers populaires de façon illégitime.
- La danse sénégalaise
 Les danses en Afrique reposent sur le cercle, symbole de vie à la fois spirituelle et temporelle. Il est impossible de dissocier la danse de la musique dont les rythmes traditionnels s’appuient principalement sur des percussions. L’improvisation créatrice vient seulement du danseur et le batteur doit suivre son pas. Une des percussions traditionnelles utilisées au Sénégal est le Sabar qui se décline sous plusieurs types : le tungune, le mbengmbeng, le nder, le gorong-mbabas ou le thiol, qui forment l’ensemble des gammes de sons. La danse la plus typique du Sénégal porte le nom d’une percussion, le « Sabar ». Le sabar est souvent éxécuté par les femmes qui s’élancent à tour de rôle au centre d’un cercle formé par les participants. Une autre percussion originale et populaire, le tama, se pratique avec une baguette et en solo notamment dans le mbalax.
Les danses en Afrique reposent sur le cercle, symbole de vie à la fois spirituelle et temporelle. Il est impossible de dissocier la danse de la musique dont les rythmes traditionnels s’appuient principalement sur des percussions. L’improvisation créatrice vient seulement du danseur et le batteur doit suivre son pas. Une des percussions traditionnelles utilisées au Sénégal est le Sabar qui se décline sous plusieurs types : le tungune, le mbengmbeng, le nder, le gorong-mbabas ou le thiol, qui forment l’ensemble des gammes de sons. La danse la plus typique du Sénégal porte le nom d’une percussion, le « Sabar ». Le sabar est souvent éxécuté par les femmes qui s’élancent à tour de rôle au centre d’un cercle formé par les participants. Une autre percussion originale et populaire, le tama, se pratique avec une baguette et en solo notamment dans le mbalax.La danse et la musique sont donc omniprésentes au Sénégal. Ces moments de fêtes on lieu dans les cours des maisons ou dans les rues et peuvent alors bloquer tout le quartier. Ils sont le plus souvent organisés par les femmes qui font appel à des musiciens pour donner les mouvements de danses. Les rythmes s’enchaînent de manière très codifiée, l’ordre d’exécution des rythmes indiquant le début et la fin de la fête.